
La rotation de Mercure
 |
. Photornosaïque de Mercure obtenue en traitant les images acquises par la sonde américaine Mariner 10 , en mars 1974 |
Avant les survols historiques de Mariner 10 , on savait peu de choses sur la planète la plus proche du Soleil . Des générations d'observateurs s'étaient pourtant succédé pour essayer de déteminer ses paramètres physiques fondamentaux, presque toujours sans aboutir à des résultats appréciables. Toutefois, l'obstination de certains hommes entreprenants avait permis de résoudre l'énigme de la rotation de Mercure avant que la planète ne fût atteinte par une sonde spatiale.
Il est souvent arrivé dans l'histoire de la science que l'observateur ne trouve que ce qu'il souhaitait trouver : une théorie convaincante peut en effet conditionner un chercheur au point de l'aveugler aux faits qui la contredisent. Cela s'est produit en partie pour la rotation de Mercure .
Au XIX siècle, les astronomes étaient arrivés à la conclusion que les marées soulevées par le Soleil sur Mercure devaient avoir synchronisé depuis longtemps sa rotation et sa période orbitale. En d'autres termes, la planète aurait dû montrer toujours la même face à l'astre du jour, comme la plupart des satellites naturels par rapport à l'astre principal, ce qui aurait eu des conséquences irnportantes pour le petit corps céleste : un hémisphère aurait donc été plongé en permanence dans la lumière du Soleil et l'autre aurait été enveloppé d'une ombre permanente. A part deux minces quartiers de longitude qui, du fait de l'excentricité de l'orbite, auraient vu alternativement le Soleil se lever un peu au-dessus de l'horizon pour disparaitre ensuite à nouveau, la surface de l'astre aurait été caractérisée par des températures extrêmes, avec un hémisphère brûlant et l'autre glacé.
Quand G. Schiaparelli observa longuement les taches élusives d'albédo de la surface avec sa lunette de 46 cm d'ouverture, il confirma que la planète montrait effectivement toujours la même face au Soleil et qu'elle accomplissait une rotation autour de son axe en une période orbitale, soit en 88 jours. Pendant trois quarts de siècle les astronomes acceptèrent ces conclusions; vers la moitié du XXe siècle, certains allèrent même jusqu'à affirmer que les mouvements de rotation et de révolution étaient synchronisés à moins d'une part pour mille!
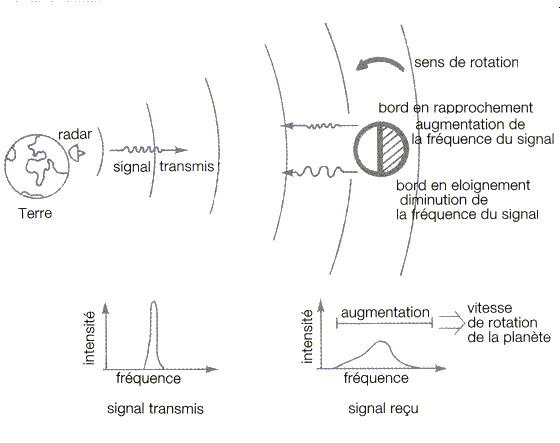 Ce schéma illustre le principe sur lequel se fonde la mesure du radar de la période de rotation d'une planète. Le signal transmis par un radar à une certaine fréquence est réfléchi en partie pâr la planète. Les surfaces qui se dépalcent vers la planète du fait de la rotation de la planète augmentent la fréquence du signal reflechi par effet de Doppler et celles qui s'éloignent la diminuent. En éliminant les effets Doppler dus aux mouvements orbitaux Terrestres, à partir de l'augmentation en fréquence du signal recu on peut trouver la vitesse de rotation de la planète et la durée de sa période de rotation. |
 |
Le radiotélescope géant d'Arecibo, utilisé comme radar très puissant, a permis de découvrir en 1965 la véritable période de rotation de Mercure . |
L'ASTRONOMIE AU RADAR
Au début des années 60, une technique astronomique révolutionnaire parvint à maturation. Un grand radiotélescope, équipé d'un transmetteur puissant, pouvait être transformé en radar capable d'envoyer un faisceau de micro-ondes vers un corps céleste relativement proche, puis de capter ensuite son écho. Le signal réfléchi per- mettrait de mesurer plus précisément les distances dans le système solaire. En outre, en mesurant le décalage Doppler du signal réfléchi on pourrait mesurer aussi la vitesse de rotation d'une surface planétaire. Bien sûr, la technique n'est pas simple : il convient également de tenir compte du fait que l'énergie de l'écho captée par le receveur est inversement proportionnelle à la puissance quatre de la distance. Si, toutes choses étant égales par ailleurs, on double la distance de la cible, l'énergie du signal de retour se réduit d'un facteur 16, ce qui limite beaucoup l'application de l'astronomie radar, c'est-à-dire aux corps célestes relativement proches.
En 1965, Pettengill et Dyce eurent l'idée d'utiliser l'énorme radiotélescope d'Arecibo, paraboloïde de 305 mètres installé dans un vallonnement naturel du terrain sur l'île de Porto Rico, comme radar gigantesque pour l'étude de Mercure . Grâce à un transmetteur d'une puissance de sortie d'environ un nillion de watts, ils envoyèrent vers la planète un signal de fréquence déterminé dont ils captèrent l'écho une dizaine de minutes plus tard. Partant de l'évalutation de l'augmentation de la fréquence, les deux astronomes furent en mesure de déterminer la période de rotation de Mercure : aux alentours de 59 jours. En 1971, Goldstein perfectionna la technique radar et obtint une valeur de 58,65 jours. Enfin, en mesurant les ombres photographiées par Mariner 10 au cours de ses survols successifs, en 1976, Klaasen obtint une valeur encore plus précise: 58,646 jours.
| Les observations faites en trois quarts de siècle des taches élusives d'albédo sur Mercure avaient confirmé l'idée erronée selon laquelle la planète montrait toujours la même face au Soleil . |  |
 |
Schérna des rotations de Mercure : la planète tourne trois fois autour de son axe alors qu'elle fait deux révolutions autour du Soleil . |
UNE NOUVELLE RÉSONANCE
Cette période correspond exactement aux 2/3 de la période orbitale, ce qui signifie qu'après deux révolutions autour du Soleil la planète a tourné 3 fois sur elle-même par rapport aux étoiles.
Pour un hypothétique habitant de Mercure la situation serait encore plus complexe: en effet après une rotation de la planète sur elle-même (jour sidéral), les 2/3 de l'orbite ont été parcourus et le Soleil parâit avoir parcouru dans le ciel seulement 1/3 de sa révolution apparente. Un jour solaire, soit le temps qui s'écoule entre deux midis, dure 2 ans sur Mercure , ou 3 jours sidéraux!
Mais pourquoi cette planète a-t- elle cette étrange relation entre rotation et révolution? Il faut chercher la réponse dans l'effet des marées solaires sur un corps non sphérique parcourant une orbite sensiblement elliptique.
Si l'orbite avait été quasi circulaire, Mercure se serait arrêtée à un rapport 1:1 entre période de rotation et période de révolution. Mais les marées solaires sont plus intenses quand la planète est au périhélie, ce qui, associé à sa forme légèrement allongée, a provoqué une "torsion" tendant à accélérer la vitesse de rotation du corps céleste.
La résonance rotation-période orbitale 3:2 semble extrêmement stable. La rotation a dû se synchroniser en moins d'un milliard d'années, alors que l'axe polaire se disposait perpendiculairement au plan de l'orbite. Et dans la mesure où un satellite qui accomplit une révolution dans un temps plus court que celui que met la pla- nète pour tourner sur elle-même finit par se précipiter sur celle-ci par les effets de marées, les éventuelles lunes de Mercure ont été détruites depuis bien longtemps...
Texte d'aprés Astronomia